Oh, boy!
2000
Que dire d'Oh, boy!? Voilà un livre qui frappe et bien que le poing risque d'avoir pris un coup de vieux, le risque en valait sincèrement la peine. Lu quand j'avais 14 ans pour un contrôle de Français, et ma qué! J'ai adoré. Ça m'a fait pleurer du premier chapitre au dernier, et je sanglotais tellement qu'impossible de reconnaître entre les pleurs et les rires. Style ironique et pointu, sachant soulever l'horreur d'une situation sans devoir l'écrire en lettres rouges de sang, mais plutôt à travers un humour sage qui n'excuse rien.
Tags: homosexualité dans la loi française, homosexualité dans la vie quotidienne du début 21ème siècle, peinture des classes et leurs violences, enfants perdus, ironie, close quarters,
garde d'enfants, face à la maladie, leçons de vie pour enfants, abus moral parental, roman de mœurs
Jacqueline Harpman
Orlanda
1996
Dans Orlanda, Harpman
se propose de nous rapprendre à être égoïste. Cela ne se fera pas sans casse…
Traitant de ce qui enferme les femmes, les contraint, les réprime : elles-mêmes…et Maman…, Harpman nous livre une drôle d’étude sur le processus de « devenir femme », qu’elle oppose à l’enfance, libre de tout rôle. Cependant, son étude sur les contraintes de la féminité devient très vite, à l’image de son analyse d’Orlando de Woolf, une étude sur le fait de « devenir » tout court, de se laisser vieillir mentalement. Le vaccin : converser avec soi-même.
Poussant le thème du narcissisme (ou l’extrême inceste) à son paroxysme, les idées d’Orlanda sont intéressantes. C’est même malin. Au fil des pages, le livre s’éloigne de l’idée de la dualité de l’identité (masculin, féminin) pour étudier l’identité même du « je », qu’importe son sexe. L’émancipation de la femme qui définit enfin par elle-même sa propre féminité, oui, c’est bien, mais surtout, et avant tout, l’émancipation du « moi », car d’autres personnages se donnent aussi une vie. Et d’autres en perdent… On part d'un blâme simpliste contre la société et l’on arrive au carrefour des choix où l’action personnelle est enfin rendue possible.
Est-ce que ça valait le coup ? C’est intéressant du point de vue du lecteur en tant qu’étude pseudo-psychanalyste, et fort divertissant en tant que roman…
Mais…
Traitant de ce qui enferme les femmes, les contraint, les réprime : elles-mêmes…et Maman…, Harpman nous livre une drôle d’étude sur le processus de « devenir femme », qu’elle oppose à l’enfance, libre de tout rôle. Cependant, son étude sur les contraintes de la féminité devient très vite, à l’image de son analyse d’Orlando de Woolf, une étude sur le fait de « devenir » tout court, de se laisser vieillir mentalement. Le vaccin : converser avec soi-même.
Poussant le thème du narcissisme (ou l’extrême inceste) à son paroxysme, les idées d’Orlanda sont intéressantes. C’est même malin. Au fil des pages, le livre s’éloigne de l’idée de la dualité de l’identité (masculin, féminin) pour étudier l’identité même du « je », qu’importe son sexe. L’émancipation de la femme qui définit enfin par elle-même sa propre féminité, oui, c’est bien, mais surtout, et avant tout, l’émancipation du « moi », car d’autres personnages se donnent aussi une vie. Et d’autres en perdent… On part d'un blâme simpliste contre la société et l’on arrive au carrefour des choix où l’action personnelle est enfin rendue possible.
Est-ce que ça valait le coup ? C’est intéressant du point de vue du lecteur en tant qu’étude pseudo-psychanalyste, et fort divertissant en tant que roman…
Mais…
- On peut compter sur la présence des éléments répétitifs de l’œuvre d’Harpman : le crime, l’idée du vice, l’inceste, l’homosexualité qu’elle traite encore, comme un enfant, ou un adulte des années 80, en jeu alléchant et interdit plutôt qu’en sexualité, tout simplement. En auteur ironique et hyper-présent, Harpman se flatte tant d’un récit à la limite du choquant qu’elle ne remarque même pas que ces choses si « choquantes », sur lesquelles elle se flatte d’avoir l’esprit ouvert, ne choquent plus qu’elle.
- Ça reste un roman plein de substance, malgré tout, même si largement puisée dans l’œuvre d’autrui (Freud, Woolf, Balzac, Julien Green, Proust, Platon,…). Jacqueline Harpman sait raconter mais on dirait presque qu’elle n’a pas assez confiance en ses propres talent et imagination pour mener l’œuvre sans s’accrocher au canon littéraire et culturel. Si elle n’était pas si obsédée par l’idée d’étaler ses connaissances en (ré)citant plein de noms, nous n’aurions pas à avoir notre lecture troublée par des racistes et des P. Bien sûr, pour ce-dernier cas, Harpman ne pouvait pas savoir à l’époque, mais c’est une bonne leçon pour tout auteur : le livre doit se vendre par lui-même, pas par les hommages et palabres culturels. Pire, ceux-ci risquent de le tâcher.
- Orlanda est avant tout le vecteur par lequel Harpman nous expose ses pensées sur la littérature. Elle déploie avec insistance son esprit analytique à l’attention du grand public. Le style en devient un peu pompeux, un peu snob, plein de fatuité, une « qualité » qu’elle loue dans son personnage Orlanda comme un signe de confiance en soi, mais qui, ici, entrave son récit.
- Il y a de très bonnes pages, bien écrites, pourtant trop souvent suivies de passages où la force d’Harpman, le lyrisme intempestif, ajouté à la technique du « stream of consciousness » et à d’innombrables virgules à la place des points et points-virgules, devient sa faiblesse. En plein milieu d’une action, elle vous inflige des tirades littéraires et des métaphores et comparaisons à n’en plus finir. Si Orlanda invite la pensée et donne beaucoup, il en perd presqu’autant par son inhabilité à se décider : est-ce une histoire qu’on nous raconte ou est-ce l’écriture qui se raconte ? Harpman met tellement l’accent sur son style qu’il entrave l’histoire, pourtant plus intéressante. Les intrusions constantes du « je » de l’auteur-narrateur dans un récit déjà bourré d’identité(s), sont tour à tour drôles et agaçantes : au moment où le récit nous étonne et l’on s’imprègne de la narration lyrique (118), Harpman casse notre élan avec ses questions-réponses qui ramènent notre attention sur elle (119). C’est un bon auteur, en général, mais dans Orlanda, elle a du mal à s’oublier pour laisser son œuvre briller d’elle-même, et semble ne pas comprendre qu’on lit son livre pour son récit et non pour l’y trouver, elle.
Si, dans ce roman, l’écriture représente l’émancipation de
soi, eh bien, je dirais que Jacqueline Harpman s’émancipe un peu trop. Orlanda est chouette, drôle, intrigant,
et capte l’attention, mais son écriture trahit un gros besoin de la part de l’auteur
d’être estimée en tant qu’écrivain de littérature. Le livre promet l’évasion, le roman, et retombe plic-ploc-plac
dans le terre à terre. Au final, donc, ni Aline, ni Orlanda, ne se révèlent des
personnalités satisfaisantes. J'ai aimé le temps de lire; je ne relirai sans doute pas une seconde fois.
Tags: quand la femme crée la femme qui refait l'homme, androgynie vs. "devenir femme; avoir été homme" ou pourquoi ne pas habiter le corps de l'autre et voir si je m'y plais?, le masculin et le féminin qui sommeillent en chacun de nous, l'enfance vs. "Maman vous dit comment..." ou la psychanalyse féministe, l'homosexualité comme un interdit attrayant (Hello, the 90s!), narcissisme
= extrême inceste; passages sexuels jusqu'au moment le plus
croustillant où, évidemment, on se détourne vers le personnage
raisonnable, un peu une peinture de la vie des bourgeois Ucclois-Forestois-Ixellois, remarques pertinentes, le "je" est-il plus que la somme du masculin et du féminin?, jeune homme blanc comme on s'y attend...ou presque! E. M. Forster
A Passage to India
1924
This is only a passage, indeed, one route at the end of which there is no single truth to rely on. There is no British India without Indians in this work and you are asked to empathise with their multiple faces as Indians and as people, rather than revealed "the truth" about India under the British Raj.
Though ever so present, the writer never takes over the story but lets the characters play it for you. Forster creates a fantastical, yet subtle, Dr. Aziz that he clearly loves. You respect him, you feel for him after the first few sentences and you know it's his shine that will carry the story. With an uncomplicated, slightly ironic style, A Passage delivers beauty of form and content that is at times subdued, at times overt, a mélange of spirituality and profound realism, a balance between the Oneness that belittles our performances and the importance of those little selves. A balance between Forster's message 'Only connect...' and the road of racial prejudices and ambivalences it takes to get there. 'Only connect' but do not negotiate the underlying truth of colonialism. A Passage to India judges without saying so.
P.S. Forster's 'Only Connect...' was the epigraph of Howards End.
Tags: feminist representation of the housewife, early 20th century, a little of that ladies & gents' courtship dance, social castes of British India, racial intercourse under the British Raj, hypocrisy of codes of conduct, drama in close quarters, mystical take on destiny, religion, Islam, Hinduism and India, hints of more than platonic homosociality, colonialism and independence, religious mysticism, national identity and Britishness, race and friendship, Oneness vs. selves..., or is it?, Overpowering nature

Jane Austen
Persuasion
1818
This is one of Austen’s more ‘tamed’ work. The book offers a study of the dilemma between reasonability and influenceability, and ends up, like all Austen, praising nuance. The heroine is restrained in her emotions, with an acute awareness of social do’s and don’ts, to the point of making you yell at her in despair. You’ll understand it, this is a story in which you can’t help but invest. With a cast of characters to die for, from the comic relief to the ‘grip-your-own-hair’ type (that’d be the heroine), the book offers a nice balance of wisdom, stock characters, social observation, suspense, indignation, comedy, and annoyance. This is a complete work, more well-rounded in its study than Northanger, if perhaps less witty. The characters are attaching, they feel real and simple, closer to a 21st-century audience than Austen’s other works.
Tags: ladies & gents' courtship dance, close quarters, 19th-century society, roman de mœurs, famille & land , gender discussion
J. M. Barrie
Peter Pan
1911
A surprising read for I had in mind the image of Peter Disney had stuck in there. And while it is safe to say that now I like Peter less, I can also say that after the very first chapter I started wishing the book itself would end up as one of my favourites. It didn’t.
You get a
pleasure in the humorous telling, the writing, that you never really get from what it
tells you. The adventures are more sad than adventurous and the Darling bits
too precious to really appreciate their antagonist, Neverland. The writing style
lost its shine as
soon as we landed on Neverland; it got in the way of the adventures, like an
annoying veil you just wanted to push aside; or else, Neverland got in the way
of our falling enthralled with that style.
It
is as if the
author knew he had something good here, and dangerous, hidden within the
treasure box of
Neverland, but could not bring himself to uncover it. He let down the
critique for the sake of the irony. You get that close to caring for
the characters and their stories, but you’re too
busy flying above them all to ever do so. Because Barrie never gets
seriously
into the adventures, it’s well easy_ too easy_ for the reader to get
out.A fine book to read, but not perhaps one that leaves a lasting impression. All its best themes ((never) growing up; the unkindness of childhood) are worth much more going into, and you turn that last page with a slight regret. You wanted to know so much more about Mrs Darling's kiss! But then, that would not have pleased Peter...
P.S. positive and less positive racial stereotypes.
Tags: arrogant cocky Peter, utopia. vs dystopia, ironic and cheeky narrator, superego vs. the id, evil or the selfishness of childhood, games and adventures, the everlasting world of children's imagination, unattainable everlasting bliss or Mrs Darling's kiss, growing up into a woman, society made of Darlings, magic dust, stuck at home, stuck on an island, allusions to a whole world beyond the book, nasty but mitigated stereotypes, of crocodiles, pirates and a useless ship, Peter Pan at the crossroads of boundaries

Jane Austen
Pride and Prejudice
1813
George Bernard Shaw
Pygmalion
(1913)
Loved it! Was so easy to read, as a play should; entertaining, without giving up on substance. It's just a real pleasure to read. There's not much to add to that.
P.S. The "What happened afterwards" bit is not really necessary and feels, at times, too fanciful to be credible, when compared to the actual play.
Tags: when Man creates and reshapes (wo)men; social mobility or how to better oneself without losing oneself; greek myth revisited; gender-role traditions vs. human connection; and man made woman...or so he thinks!; language as life; meeting and meddling of london's social classes; early 20th-century English social world; wit and irony; nature vs. nurture

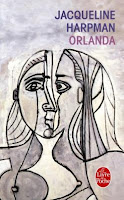


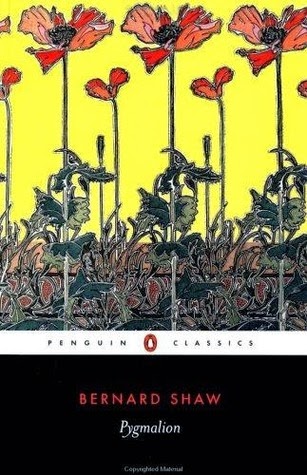
No comments:
Post a Comment